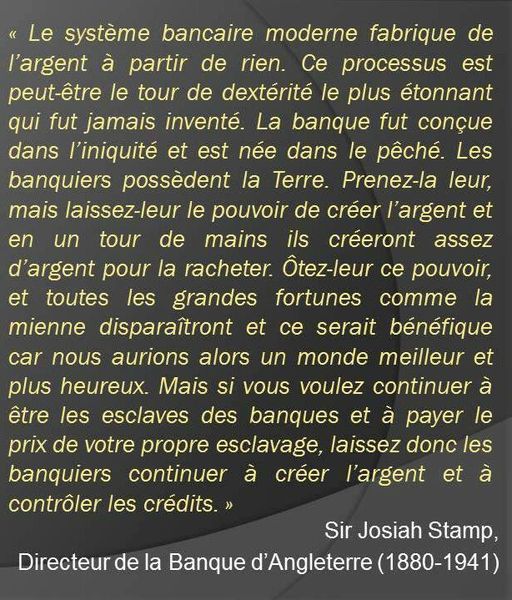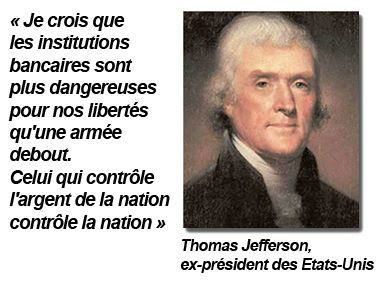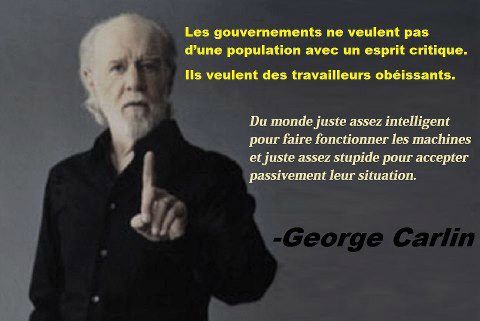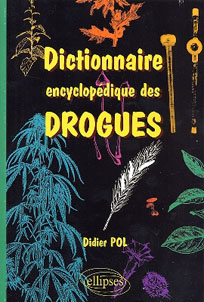ARPANET ou Arpanet (acronyme anglais de « Advanced Research Projects Agency Network », souvent typographié « ARPAnet ») est le premier réseau à transfert de paquets développé aux États-Unis par laDARPA. Le projet fut lancé en 1969 et la première démonstration officielle date d'octobre 1972.
Le concept de transfert de paquets (packet switching), qui deviendra la base du transfert de données sur Internet, était alors balbutiant dans la communication des réseaux informatiques. Les communications étaient jusqu'alors basées sur la communication par circuits électroniques, telle que celle utilisée par le réseau de téléphone, où un circuit dédié est activé lors de la communication avec un poste du réseau.
Les ordinateurs utilisés comprenaient des Univac fonctionnant avec des tubes électroniques, technologie certes désuète en 1969 (où on abandonnait déjà les ordinateurs de deuxième génération transistorisés pour d'autres à circuits intégrés comme l'IBM 1130), mais c'est précisément pour cela que ces ordinateurs étaient libres pour un usage expérimental, les autres étant saturés de travaux.
Création d'Arpanet
En 1961, l'US Air Force confie à la DARPA, agence de recherche technologique de défense américaine créée 3 ans plus tôt, un puissant ordinateur, le seul de sa série construit par IBM, le Q-32, pour concevoir un programme destiné au commandement des bombardements stratégiques. Joseph Licklider, docteur en psychoacoustique mais surtout spécialiste des technologies de l'information est engagé. Il a auparavant travaillé sur un programme d'ordinateurs envoyant des données par lignes téléphoniques pour un système de défense antiaérien, le projet SAGE. En 1962 il rejoint l'Arpa et prend la direction du « bureau Contrôle-Commande » nouvellement créé. Il fait venir Fred Frick qui a travaillé avec lui au Lincoln Laboratory sur le projet SAGE (en). Ils sont tous les deux partisans du temps partagé sur les ordinateurs, des machines alors très couteuses pour permettre à différents centres de recherche, universités ou entreprises de travailler sur une même machine. Ils vont donc dès 1962 commencer à réfléchir à interconnecter informatiquement tous les centres de recherches américains avec lesquels l'Arpa travaille. Le but est alors de partager plus facilement ressources et données et surtout de faire baisser les coûts et limiter les doublons en recherche. En 1964, le « bureau Contrôle et commande » devient « Bureau des techniques de traitement de l'information » ou IPTO (Information Processing Techniques Office).
Ils recrutent alors Robert Taylor, 32 ans, psychologue et mathématicien de formation qui a travaillé pour la Nasa et Ivan Sutherland, 27 ans, qui étudie les interactions entre ordinateurs. Il succède en 1964 à Licklider parti au MIT et en 1966, et est lui-même, après son départ à Harvard, remplacé par Robert Taylor à la tête de l'IPTO.
En 1966, Charles Herzfeld, le directeur de l'Arpa, accorde un budget d'un million de dollars pour que l'IPTO développe le projet de création d'un réseau informatique délocalisé, reliant les universités en contrat avec la DARPA. Il recrute Larry Roberts qui travaille au Lincoln Lab sur le transfert de données entre ordinateur. En 1968, il aura couché sur papier les plans du réseau informatique.
En juillet 1968, l'Arpa-ipto lance une consultation pour la conception d'un réseau à petite échelle pour relier l'institut de recherche de Standford, l'université de Los Angeles (UCLA) et l'université de l'Utah. Plus d'une centaine d'entreprises et de centres d'études sont approchés mais déclinent l'appel d'offre, dont IBM. C'est finalement un petit cabinet de consultants informatique du Massachusetts, Bolt Beranek et Newman qui remporte le marché. Une équipe de sept personnes se met en place avec Frank Heart à sa tête et vont concevoir le réseau avec de petits ordinateurs les Interfaces Messages Processors ou IMP (ancêtres des actuels routeurs) qui assurent la connexion des ordinateurs hotes au réseau et permettre le transfert de données par la commutation de paquets à la vitesse alors de 50kbits par seconde.
Opérationnel le 20 septembre 1969, Arpanet sert de banc d'essai à de nouvelles technologies de gestion de réseau, liant plusieurs universités et centres de recherches. Les deux premiers nœuds qui forment l'Arpanet sont l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et l'Institut de recherche de Stanford (le premier message, le simple mot login sera envoyé sur le réseau le 29 octobre 1969 entre ces deux institutions, suite à un bug, les 3 dernières lettres mettront une heure pour arriver), suivis de peu par les universités de Californie à Santa Barbara et de l'Utah.
Le mythe veut que l'objectif fixé à Arpanet soit de permettre aux réseaux de communication militaires (Arpanet voit le jour en pleine guerre froide) de continuer à fonctionner malgré une attaque nucléaire massive de la part de l'Union soviétique, c’est-à-dire : « garder ouvertes des voies de communication quel que soit l'état de destruction du pays » (les États-Unis). Les chercheurs, majoritairement financés par la même DARPA, peuvent utiliser les unités centrales de n'importe quel des établissements gérés en réseau, qu'il soit universitaire ou militaire.
La véritable raison est qu'Arpanet est créé afin d'unifier les techniques de connexion pour qu'un terminal informatique se raccorde à distance à des ordinateurs de constructeurs différents.
Les premiers essais sont concluants, et le projet - considéré comme ancêtre de l'Internet, compte tenu de son mode de fonctionnement - est mené à son terme: Lorsqu'un des centres (nœuds) est virtuellement détruit, les données empruntent d'autres chemins et d'autre nœuds pour atteindre les destinataires désignés.
Très rapidement, la CIA conclut à l'invulnérabilité d'Arpanet, alors que dans les faits cette « invulnérabilité » est sujette à caution.
Développement
Rapidement, de nouveaux raccordements furent bientôt ajoutés au réseau, portant le nombre de « nœuds » à 23 en 1971, qui se monteront à 111 en 1977.
En 1974, le TCP/IP (Transmission Control Protocol et Internet Protocol) est créé pour uniformiser le réseau ; le système est toujours utilisé de nos jours.
En 1980, Arpanet se divise en deux réseaux distincts, l'un militaire (MILNET, de « Military Network », qui deviendra le DDN — Defense Data Network) et l'autre, universitaire (NSFnet), que les militaires abandonnèrent au monde civil.
Le 1er janvier 1983, ARPANET adopte le TCP/IP qui sera la base d'Internet.
En 1984, DDN et NSFnet comptent déjà près de 4 millions de nœuds interconnectés et plus de 1 000 ordinateurs à travers le monde y sont reliés
.


RESUME HISTORIQUE.......
1792 : Les frères Chappe inventent le télégraphe optique en France. Il permet d'envoyer des messages rapidement sur une longue distance en utilisant un réseau de tours surmontées d'un bras articulé pour transmettre à vue des signaux codés.
1836 - 1838 : Les Anglais Edward Davy, William Looke et Charles Wheastone vont inventer et mettre au point le télégraphe.
Le peintre Américain Samuel Morse invente le code qui porte son nom utilisant des points et des traits pour représenter les caractères à transmettre.
24 Mai 1844 : Samuel Morse effectue la première démonstration publique du télégraphe en envoyant le message "What hath God wrought ?" sur une distance de 60 km entre Philadelphie et Washington.
Les réseaux télégraphiques vont très rapidement se développer dans le monde (37000 km de lignes installlées en 10 ans).
1858 : Le premier cable transatlantique est tiré entre les Etats Unis et l'Europe pour interconnecter les systèmes de communication Américains et Européens. Il cessa de fonctionner au bout de quelques jours ! Un second cable transatlantique fût tiré en 1866 et resta en exploitation pendant une centaine d'années.
1876 : L'Américain Graham Bell invente le téléphone et fonde la compagnie Bell Telephone Company.
1955 : Premier réseau informatique à but commercial : SABRE (Semi Automated Business Related Environment) réalisé par IBM. Il relie 1200 téléscripteurs à travers les Etats-Unis pour la réservation des vols de la compagnie American Airlines.
1957 : Suite au lancement du premier Spoutnik par les Soviétiques, le président Dwight D. Eisenhower crée l'ARPA (Advanced Research Project Agency) au sein du DoD (Department of Defense) pour piloter un certain nombre de projets dans le but d'assurer aux USA la supériorité scientifique et technique sur leurs voisins Russes.
Juillet 1958 : Le premier bunker du réseau SAGE (système de défense Américain) devient opérationnel. L'ordinateur AN/FSQ7 (dont le WhirlWind de 1951 était le prototype) dans chaque bunker est capable de gérer 400 avions simultanément. Le dernier bunker du réseau SAGE fermera en Janvier 1984.
1958 : La BELL crée le premier Modem permettant de transmettre des données binaires sur une simple ligne téléphonique.
Juillet 1961 : Leonard Kleinrock du MIT publie une première théorie sur l'utilisation de la commutation de paquets pour transférer des données.
Octobre 1962 : Le docteur J.C.R. Licklider du MIT est nommé à l'ARPA pour diriger les recherches pour une meilleure utilisation militaire de l'informatique. Il avait écrit en Août une série de notes décrivant sa vision d'un "réseau galactique" permettant à toute personne d'accéder rapidement à toute information ou tout programme, où qu'il se trouve. Il convaincra ses successeurs, Ivan Sutherland, Bob Taylor et Lawrence G. Roberts du MIT de l'importance de ce concept de réseau.
1964 : Leonard Kleinrock du MIT publie un livre sur la communication par commutation de paquets. Il va convaincre Lawrence G. Roberts du bien fondé de l'utilisation de la commutation de paquets plutôt que de circuits dédiés pour réaliser un réseau.
1965 : Lawrence G. Roberts va, avec Thomas Merill, connecter l'ordinateur TX-2 au Massachussets avec l'ordinateur Q-32 en Californie par une liaison téléphonique. Cette expérience va prouver la faisabilité et l'utilité d'un réseau d'ordinateurs. Elle va aussi achever de convaincre Roberts de la supériorité de la commutation de paquet par rapport à l'utilisation de circuits dédiés comme ce fût le cas dans cette expérience.
1967 : Lawrence G. Roberts, récemment arrivé à la tête du projet de réseau informatique à l'ARPA, publie ses "Plans pour le réseau ARPANET" au cours d'une conférence. Lors de cette conférence sera aussi publié un papier sur un concept de réseau à commutation de paquets par Donald Davies et Robert Scantlebury du NPL et également un papier de Paul Baran de la RAND au sujet de l'utilisation d'un réseau à commutation de paquet pour transmission sécurisée de la voix, même en cas de destruction partielle du réseau en cas de guerre nucléaire.
Il est amusant de noter que ces groupes ont travaillé en parallèle sur des concepts similaires et sans avoir connaissance des travaux des autres pour aboutir en même temps à la même conclusion !
C'est aussi à cause de la similitude entre le projet de la RAND et le projet de l'ARPA qu'est née la fausse rumeur selon laquelle le réseau ARPANET avait été lancé à cause du besoin de relier les ordinateurs entre eux par un réseau insensible aux destructions d'une guerre nucléaire.
Aout 1968 : Lawrence G. Roberts et la communauté de chercheurs "sponsorisée" par l'ARPA ont défini la structure et les spécifications du futur réseau ARPANET. Ils lancent un appel d'offre pour la réalisation d'un composant clé du réseau : le commutateur de paquet appelé aussi IMP (Interface Message Processor). La société BBN (Bolt Beranek and Newman) remportera l'appel d'offre en Décembre 1968.

Septembre 1969 :
BBN installe le premier équipement réseau IMP (basé sur un mini-ordinateur Honeywell 516 avec 12 Ko de Ram, voir photo ci-contre) à l'UCLA et le premier ordinateur (XDS SIGMA 7) y est connecté. Un ordinateur (XDS 940) de l'équipe de Douglas C. Engelbart de la Stanford Research Institute est alors relié via une liaison à 50 kbits/s. Les premières données sont échangées entre ces machines. Peu après, un ordinateur (IBM 360/75) situé l'université de Santa Barbara et un autre (Dec PDP-10) situé à l'université de l'Utah à Salt Lake City sont raccordés. Le réseau ARPANET initial constitué de 4 ordinateurs est alors en fonctionnement fin 1969.
Voici un schéma de l'époque représentant ce réseau.
Lors d'une interview, le professeur Kleinrock de l'UCLA raconta la première expérience réalisée avec ce réseau : se connecter à l'ordinateur de la SRI depuis celui de l'UCLA en tapant LOGIN :
Nous avons appelé les gens de SRI par téléphone.
Nous avons alors tapé L puis demandé au téléphone "Vous voyez le L ?"
La réponse vint alors : "Oui, nous voyons le L"
Nous avons alors tapé O puis redemandé au téléphone "Vous voyez le O ?"
"Oui, nous voyons le O"
Nous avons alors tapé G et tout le système a crashé !!! |
1969 : Création de la norme de connexion série RS232.
Décembre 1970 : Le Network Working Group sous la direction de S. Crocker termine le protocole de communication entre ordinateurs pour le réseau ARPANET appelé Network Control Protocol ouNCP. De nouveaux ordinateurs furent rapidement branchés sur ARPANET et l'implémentation de NCP sur la période 1971-1972 permit aux utilisateurs de ce réseau de développer les premières applications.
Avril 1971 : A cette époque, le réseau ARPANET est constitué de 23 ordinateurs sur 15 sites différents reliés par des liaisons à 50 kbits/s.
Mars 1972 : Ray Tomlinson de BBN réalise la première application réseau majeure pour ARPANET : un logiciel basique de courrier électronique répondant au besoin de communication des développeurs du réseau.
Juillet 1972 : Lawrence G. Roberts améliore les possibilités du courrier électronique en écrivant un logiciel permettant de lister, lire sélectivement, archiver, répondre ou faire suivre son email. A partir de cet instant, la messagerie électronique va devenir pour les dix années qui vont suivre l'application réseau majeure.
Octobre 1972 : Une démonstration publique du réseau ARPANET fut réalisée lors de la première conférence sur les communications informatiques à Washington. Un IMP et 40 terminaux furent raccordés au réseau pour la durée de la conférence. Plusieurs pays se mirent d'accord sur la nécessité de mettre en place des protocoles de communication communs, ce qui mena à la création du groupe de travailINWG (InterNetwork Working Group), dirigé par Vinton Cerf.
1972 : L'ARPA est renommé DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).
1972 : Le succès du programme d'email sur ARPANET a presque aussitôt entraîné la création des mailing-lists (listes de diffusion).
L'une des premières mailing-list avec un volume de messages très important fût SF-LOVERS, dédiée à la discussion entre fans de Science Fiction :-)
1972 - 1973 : Bob Kahn travaille au sein du DARPA sur un projet de commutation de paquets par radio ce qui nécessite la création d'un nouveau protocole capable de transmettre les paquets d'informations, quelles que soient les perturbations radio. Ayant été un architecte majeur de l'ARPANET, il envisagea d'utiliser NCP (protocole réseau de l'ARPANET). Mais ce protocole étant insuffisant (pas de contrôle d'erreur, pas de possibilité d'adresser des machines au delà d'un IMP (équipement réseau). Il décida alors, en collaboration avec Vinton Cerf, chercheur à Stanford, de réaliser un nouveau protocole répondant à ce cahier des charges et permettant de relier les réseaux (internetting). C'est ainsi que fut crée TCP/IP (Transmission Protocol, Internet Protocol).
Un premier papier sur TCP/IP fut publié par ces deux chercheurs en Septembre 1973 lors d'une conférence de l'International Network Working Group (INWG).
Janvier 1973 : A cette date, 35 machines sont maintenant connectées sur le réseau ARPANET. Une première liaison satellite est mise en place pour raccorder l'Université de Hawai sur le réseau.
1973 : Bob Metcalfe met au point l'interface réseau Ethernet chez Xerox en s'inspirant des principes du réseau informatique radio de l'université de Hawai : Alohanet.
1974 : La société BBN lance Telenet, le premier réseau à commutation de paquets à usage commercial (utilisation des technologies employées sur ARPANET)
1975 : Première release du Jargon File par Raphael Finkel !
1976 : Fondation de la firme U.S. Robotics.
1976 : Les laboratoires Bell d'AT&T développent UUCP (Unix to Unix Copy Program). Il s'agit du premier protocole d'échanges de données largement disponible et qui sera énormément utilisé avant l'avènement de TCP/IP et d'Internet.
1976 : Le DoD (Department of Defense) commence ses expérimentations sur TCP/IP et décide rapidement de migrer le réseau ARPANET vers ce protocole.
1976 : A ce moment, le réseau ARPANET, en incluant les liaisons radio et satellite est composé de 111 ordinateurs.
1976 : Adoption de la norme X25 par le CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique) décrivant l'interfaçage des terminaux sur un réseau de communication par paquets. Cette norme a été définie dans l'urgence pour éviter qu'IBM n'impose mondialement sa propre norme propriétaire SNA (Systems Network Architecture).
Juillet 1977 : Première démonstration de l'interconnexion des réseaux ARPANET, Packet Radio Net et SATNET grâce à l'utilisation du protocole TCP/IP.
Février 1978 : Création du premier BBS (Bulletin Board System) à Chicago par Ward Christianson et Randy Suess. Il s'appelait RCPM (Remote C/PM).
Ward Christianson est par ailleurs l'auteur du protocole de transfert de fichiers par modem XModem.
1978 : La DGT installe sur toute la France son réseau de communication à haut débit TRANSPAC fonctionnant sur le principe de la commutation de paquets.
1978 : Le CCITT définit le modèle standard de transmission de terminal à terminal, ou modèle OSI (Open Systems Interconnect) en 7 couches pour amener la standardisation au sein de la jungle des protocoles de communication de tous les constructeurs informatiques.
Juin 1979 : Bob Metcalfe quitte le Xerox Parc ou il a mis au point le réseau Ethernet et fonde sa propre société 3Com pour commercialiser des cartes Ethernet.
Juillet 1979 : Compuserve lance son premier service en ligne pour les fans de micro informatique : MicroNET.
1979 : Hayes sort un modem 110/300 bauds pour l'Apple ][. Il est vendu 380 $.
Fin 1979 : Apparition des groupes de conversation USENET (Unix User Network). Tout a commencé quand Steve Bellovin (de l'université de Caroline du Nord) a écrit un script shell sous Unix V7 pour tester un système d'échange de messages classés par catégorie entre serveurs Unix en utilisant le protocole UUCP. Tom Truscott, Jim Ellis et Dennis Rockwell (de l'Université de Duke) avaient eu cette idée en utilisant un programme d'échange local de messages utilisé dans les deux universités.
Un autre étudiant de l'université de Duke, Stephen Daniels réécrivit ce shell en langage C, donnant ainsi le jour à la première version officielle appelée A News.
Deux serveurs, un dans chaque université, reliés par UUCP, formèrent le début d'USENET (USEr NETwork). Les premiers groupes de nouvelles étaient subdivisés en deux hiérarchies : net.* et dept.* L'un des premiers groupes de nouvelles créé fut net.chess
Août 1980 : Vinton Cerf, scientifique au DARPA propose un plan d'interconnexion (inter-network connection) entre les réseaux CSNET et ARPANET utilisant le protocole TCP/IP. Il sagit du point de départ du réseau internet tel que nous le connaissons actuellement.
été 1980 : De nouveaux sites s'interconnectent sur le réseau USENET. Voici un schéma de l'époque représentant les interconnexions :
reed phs 1) duke Duke University
\ / \ 2) unc University of North Carolina at Chapel Hill
uok --- duke --unc 3) phs Physiology Dept. of the Duke Medical School
/ \ 4) reed Reed College
research vax135 5) uok University of Oklahoma
| 6) research Bell Labs Murray Hill
ucbvax 7) vax135 Bell Labs Murray Hill
8) ucbvax University of California at Berkeley
1980 : La DGT lance une expérience d'Annuaire Minitel Electronique en Bretagne.
Août 1981 : Nombre de machines connectées sur Internet : 213
1981 : La DGT lance une expérience à grande échelle de son terminal télématique Minitel à Vélizy, Versailles et Val de Bièvre.
1981 : La NSF (National Science Foundation) lance CSNET (Computer Science Network), un réseau d'ordinateurs universitaires reliés entre eux par des liaisons 56 kBits/s et non reliés à ARPANET.
1981 : Matt Glickman et Mark Horton de l'université de Berkeley écrivent la version "B" du logiciel gérant les news USENET. vous trouverez ici un schéma du réseau de l'ensemble des serveurs de News de l'époque. Voici la première liste des newsgroups publiée sur USENET le 26 Janvier 1982.
Mai 1982 : Nombre de machines connectées sur Internet : 235
1982 : L'ARPA choisis les protocoles TCP (Transmission Control Protocol) et IP (Internet Protocol) pour la communication sur le réseau ARPANET.
1982 : Le réseau EUnet (European Unix network) est mis en place pour interconnecter les machines Européennes et permettre la circulation de l'email et des news USENET. Les premiers pays raccordés sont la Hollande, le Danemark, la Suède et l'Angleterre.
1er Janvier 1983 : Le réseau ARPANET bascule du protocole NCP vers le protocole TCP/IP.
Aout 1983 : Nombre de machines connectées sur Internet : 562
1983 : Une passerelle est mise en place pour interconnecter ARPANET et CSNET.
1983 : Gene Spafford organise le Backbone USENET, c'est à dire un ensemble de serveurs reliés entre eux sur Internet et s'échangeant les news rapidement pour aider au fonctionnement global d'USENET. C'est de la qu'est née la légende du Backbone Cabal, devenue depuis la Usenet Cabal, formée des administrateurs des serveurs de News du Backbone participant à une mailing-list décidant de la création des nouveaux groupes de nouvelles.
Janvier 1984 : Suite à un long procès pour violation de la loi antitrust la société AT&T Bell Systems est dissoute et réorganisée en de nombreuses sociétés plus petites surnommées les Baby Bells.
Juin 1984 : Le logiciel FidoBBS est programmé par Tom Jennings , sysop du serveur FidoBBS à San Francisco. Grâce à ce logiciel, il a été possible de mettre en place un réseau de micro ordinateurs permettant l'échange de courrier et de forums entre toutes les machines interconnectées, créant ainsi le réseau mondial Fidonet entièrement géré par des particuliers.
A la fin de l'année 1984, plusieurs dizaines de BBS étaient déjà interconnectés.
Avant d'être sur internet, votre serviteur a passé beaucoup de temps entre 1990 et 1995 sur ce réseau :-)
Octobre 1984 : Nombre de machines connectées sur Internet : 1024
|

1984 : Sandy Lerner et Len Bosack fondent la société Cisco Systems dans le salon de leur maison (Cf. photo !) pour fabriquer et vendre les premiers Routeurspermettant d'interconnecter divers réseaux entre eux pour former un réseau global.
Ils viennent tous deux de l'Université de Stanford ou ils ont mis au point le réseau global du campus.
Le nom de la société vient de San FranCisco ou ils habitaient et le logo de la socié est une représentation du Golden Gate bridge.
|
1984 : Mise en place du DNS (Domain Name Server) sur Internet. Jusque la, pour trouver une machine sur Internet, il fallait soit connaître son adresse numérique, soit tenir à jour un unique fichier texte contenant le nom et l'adresse numérique correspondante de toutes les machines de l'Internet, ce qui est rapidement devenu impossible avec la rapide croissance de ce réseau.
Octobre 1985 : Nombre de machines connectées sur Internet : 1961
1985 : La NSF (National Science foundation) forme le réseau NSFNET reliant 5 sites équipés de super ordinateurs avec des liaisons à 56 kbits/s : L'université de Princeton, Pittsburgh, l'université de Californie à San Diego, l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign et l'université de Cornell.
Ce "backbone" va également permettre de relier tous les réseaux régionaux utilisant le protocole TCP/IP, faisant ainsi disparaitre les frontières entre ces réseaux et former un vrai réseau global interconnectant toutes les universités américaines et aussi quelques réseaux Européens et Canadiens.
Février 1986 : Nombre de machines connectées sur Internet : 2308
Novembre 1986 : Nombre de machines connectées sur Internet : 5089
la mini informatique......
L'ordinateur devient interactif
Jusque la, l'ordinateur était une énorme machine inaccessible et destinée à traiter des masses de données sans intervention extérieure. L'augmentation des performances va maintenant permettre à l'ordinateur de "communiquer" avec l'être humain ! C'est aussi à ce moment que le premier réseau d'ordinateurs ARPANET, ancêtre d'Internet, va naître.
1956 : Création du premier ordinateur à transistors par la Bell : le TRADIC qui amorce la seconde génération d'ordinateurs.
|

1956 : IBM commercialise le premier disque dur, le RAMAC 305 (Random Access Method of Accounting and Control).
Il est constitué de 50 disques de 61 cm de diamètre et peut stocker 5 Mo.
Ce périphérique a été développé pour le projet SABRE, système de réservation temps réel pour la compagnie aérienne American Airlines.
|

1957 : Création du TX0 au laboratoire de Lincoln par une partie de l'équipe qui a crée le WhirlWind. Son but était seulement de tester la technologie des transistors et des mémoires à tores de ferrite. La grande rapidité de cette machine, sa simplicité et son interactivité en font un peu l'ancêtre des minis et des micros.
| Caractéristiques techniques du TX0 |
Processeur 18 bits - 3500 transistors
83000 instructions par seconde
Mémoire : 65536 mots
Entrées : clavier - stylo optique
Sorties : ecran graphique - imprimante
Consomation : 1000 Watts |
1957 : Création du premier langage de programmation universel, le FORTRAN (FORmula TRANslator) par John Backus d'IBM.
|

1957 : Création du premier ordinateur soviétique transistorisé sous la direction de Mikhail Kartsev. Une série d'ordinateurs sur ce modèle furent fabriqués à partir de 1963 pendant 15 ans. Certains M4 seraient encore en production !
|
1957 : Suite au lancement du premier Spoutnik par les Soviétiques, le président Dwight D. Eisenhower crée l'ARPA (Advanced Research Project Agency) au sein du DoD (Department of Defense) pour piloter un certain nombre de projets dans le but d'assurer aux USA la supériorité scientifique et technique sur leurs voisins Russes.
Juillet 1958 : Le premier bunker du réseau SAGE (système de défense Américain) devient opérationnel. L'ordinateur AN/FSQ7 (dont le WhirlWind de 1951 était le prototype) dans chaque bunker est capable de gérer 400 avions simultanément. Le dernier bunker du réseau SAGE fermera en Janvier 1984.
1958 : Pierre Chenus, Jean Bosset, et J.P. Cottet de la Compagnie des Machines Bull développent le Gamma 60, le premier superordinateur Français dédié au calcul intensif avec un support hardware du multithread. Cette machine très rapide et très en avance sur son temps sera fabriquée à 12 exemplaires.
1958 : Suite à une conférence entre Américains et Européens est lancée l'idée d'un langage standard universel : ALGOL 58 (ALGOrithmic Language).
|
1958 : Lancement du premier ordinateur commercial entièrement transistorisé, le CDC 1604, développé par Seymour Cray.
|
|
 1958 : Démonstration du premier circuit intégré crée par Texas Instruments. 1958 : Démonstration du premier circuit intégré crée par Texas Instruments.
|
1958 : La BELL crée le premier Modem permettant de transmettre des données binaires sur une simple ligne téléphonique.
|

1958 : John Mc Carthy, mathématicien au MIT qui y a fondé en 1957 le département d'Intelligence Artificielle, crée le langage de programmation LISP (LISt Processing) qui va avoir une grande influence sur le développement de la programmation objet. Ce langage sera initialement développé sur IBM 7090.
|
1958 : Willy Higinbotham, physicien au Brookhaven National Laboratory crée le premier vrai jeu vidéo de l'histoire basé sur une machine dédiée construite à base de lampes. Il s'agissait d'un jeu très similaire au jeu Pong qu'Atari sortira en 1972.
|

Octobre 1959 : IBM annonce l'IBM 1401. Cette machine, orientée vers l'administration, la comptabilité ou le traitement de données, remportera un grands succès (12000 exemplaires) auprès des clients traditionnels d'IBM : les utilisateurs de systèmes de comptabilité électromécaniques à cartes perforées.
L'un des attraits de ce système pour la clientèle était l'imprimante rapide IBM 1403 capable d'imprimer 600 lignes à la minute.
|
|
1959 : Digital crée le PDP-1, le premier ordinateur commercial interactif (par opposition aux gros ordinateurs traditionnels de calcul). Ce fût aussi le premier ordinateur "amusant" à utiliser, du fait de son interactivité. Il est en fait très proche dans son utilisation des premiers micro ordinateurs qui seront vendus 20 ans plus tard.
Une bonne partie des personnes qui ont développé le PDP-1 viennent des équipes qui ont réalisé le WhirlWind et le TX0.
|
1959 : L'ordinateur ATLAS I étudié par l'université de Manchester et Ferranti introduit deux nouvelles technologies fondamentales pour les ordinateurs modernes : la mémoire virtuelle et la multiprogrammation (on dirait aujourd'hui multi-tache).
L'execution des instructions s'effectuait en "pipeline" et la machine disposait d'une unité de calcul sur les entiers et une unité de calcul en virgule flottante. Elle développait une puissance de 200 kFLOPS.
|

1960 : SpaceWar!, le second jeu vidéo de l'histoire (en fait le premier jeu vidéo interactif tournant sur ordinateur) est développé sur Dec PDP-1 par S. Russel, J.M. Graetz et W. Wiitanen, étudiants au MIT.
Par la suite, Dec fournit gracieusement Space War avec chaque machine vendue.
Un étudiant de l'université de l'Utah ou se trouvait un PDP-1 passa beaucoup de temps à jouer avec Space War. Il s'agissait d'un certain Nolan Bushnell qui fonda plus tard la firme Atari !
|
1960 : Publication du cahier des charges du langage de programmation COBOL (COmmon Business Oriented Language). Il devient, après le FORTRAN, le second grand langage de programmation universel, faisant ainsi rapidement disparaître l'ALGOL.
Juillet 1961 : Leonard Kleinrock du MIT publie une première théorie sur l'utilisation de la commutation de paquets pour transférer des données.
Novembre 1961 : Fernando Corbato et Robert Fano du MIT font la demonstration de CTSS (Compatible Time Sharing System) le premier système d'exploitation multi-utilisateurs. Lors de cette démonstration, 3 utilisateurs se sont connecté simultanément sur un ordinateur pour y travailler comme si chacun disposait de sa propre machine.
CTSS sera utilisé en production au MIT entre 1963 et 1973.
1961 : Le projet MAC (Multi Access Computer) du MIT dirigé par John Mc Carthy a pour but de permettre à plusieurs personnes de travailler sur un même ordinateur en même temps pour éliminer les temps d'attente du traitement par lot.
|

1961 : Le premier IBM 7030 Stretch est installé au Los Alamos National Laboratory (LANL). Il s'agit d'un projet débuté en 1956 et mené conjointement par IBM et le LANL. Grâce à cette technologie, son processeur est deux fois plus rapide et sa mémoire 6 fois plus rapide que l'IBM 704.
|
1961 : Fairchild Semiconductors commercialise la première série de circuits intégrés.
Octobre 1962 : Le docteur J.C.R. Licklider du MIT est nommé à l'ARPA pour diriger les recherches pour une meilleure utilisation militaire de l'informatique. Il avait écrit en Août une série de notes décrivant sa vision d'un "réseau galactique" permettant à toute personne d'accéder rapidement à toute information ou tout programme, où qu'il se trouve. Il convaincra ses successeurs, Ivan Sutherland, Bob Taylor et Lawrence G. Roberts du MIT de l'importance de ce concept de réseau.
1962 : Le mathématicien canadien Kenneth Iverson crée le langage de programmation APL (A Programming Language).
|
1962 : Voici un tableau récapitulatif du nombre d'ordinateurs produits lors de l'année 1962 :
|
| Rang |
Compagnies |
Production |
Part de marché |
| 1 |
IBM |
4806 |
65.8 % |
| 2 |
Rand |
635 |
8.7 % |
| 3 |
Burrough |
161 |
2.2 % |
| 4 |
CDC |
147 |
2.0 % |
| 5 |
NCR |
126 |
1.7 % |
| 6 |
RCA |
120 |
1.6 % |
| 7 |
General Electric |
83 |
1.1 % |
| 8 |
Honeywell |
41 |
0.6 % |
| Autres |
1186 |
16.3 % |
| Total |
7305 |
100 % |
|
1962 : En France, Philippe Dreyfus invente le mot informatique pour désigner la science du traitement de l'information et des ordinateurs.
1963 : Aux Etats-Unis, Teletype développe le prototype de la première imprimante à jet d'encre : la Teletype Inktronic. La version commerciale de cette imprimante disposait de 40 buses fixes permettant d'imprimer des caractères ASCII sur 80 colonnes reçus par une liaison 1200 bauds.
|

1963 : Au MIT, Ivan Sutherland met au point le premier logiciel graphique interactif utilisant un stylo optique pour dessiner sur écran des schémas techniques.
|
|

Mars 1964 : Lancement de la série des ordinateurs IBM 360. Jusque la, chaque nouvel ordinateur qui sortait était complètement incompatible avec les précédents.IBM avec la série 360 (compatibles à 360 degrés), inaugure le concept d'une lignée d'ordinateurs compatibles entre eux. Cette série eut un grand succès commercial.
|
|

1962 - Septembre 1964 : John Kemeny et Tom Kurtz du Dartmouth College développent le système d'exploitation DTSS (Dartmouth Time Sharing System) permettant à 32 personnes de se connecter simultanément sur un même ordinateur.
L'ensemble était utilisé pour donner des cours de langage BASIC aux étudiants.
|
1964 : Thomas Kurtz et John Kemeny créent le langage BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) au Dartmouth College pour leurs étudiants.
1964 : Leonard Kleinrock du MIT publie un livre sur la communication par commutation de paquets. Il va convaincre Lawrence G. Roberts du bien fondé de l'utilisation de la commutation de paquets plutôt que de circuits dédiés pour réaliser un réseau.
1964 : IBM crée le langage de programmation PL/I (Programming Language I).
1964 : Création du code ASCII (American Standard Code for Information Interchange), normalisé en 1966 par l'ISO pour simplifier l'échange de données entre ordinateurs. Malgré cela, IBM maintient sa propre norme propriétaire EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code).
|

1964 : Lancement du super ordinateur CDC 6600 développé par Seymour Cray. Sa mise au point sera délicate mais ce sera un grand succès.. Puissance : 3 MIPS.
Control Data rencontrera de gros problèmes à cause d'IBM qui annoncera presque aussitôt le super ordinateur IBM 90 concurrent direct du CDC 6600. L'annonce de cette machine non existante avait pour but de retenir les clients d'acheter un CDC 6600 en attendant la sortie de la machine IBM. IBM tentera à nouveau la même opération lors de la sortie du CDC 7600 en 1969 mais sera cette fois-ci lourdement condamné pour ce genre de pratiques.
|
1964 : Le MIT s'allie avec General Electric et les Bell Labs d'AT&T dans le projet MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service) qui durera plusieurs années pour développer un prototype de nouvel ordinateur ainsi qu'un nouveau système d'exploitation temps partagé (time sharing). Le MIT et Bell Labs avaient déjà une expérience dans le domaine avec CTSS (MIT Compatible Time-Sharing System) et BESYS. Le but du projet était de créer un système d'exploitation pour ordinateur parfaitement fiable, capable de tourner 24H sur 24, 7 jours sur 7, utilisable par plusieurs personnes à la fois et capable en même temps de faire tourner des calculs en tâche de fond.
|

1965 : Développement du super ordinateur soviétique BESM-6 sous la direction de Sergei Alexeevich Lebedev de la société ITMiVT. Cette machine équipée d'une processeur 48 bits à 9 MHz et de 192 Ko de mémoire à tores de ferrite développait une puissance de 1 MIPS.
Cette machine d'usage civil et militaire sera fabriquée à 350 exemplaires jusqu'au début des années 80. Le dernier BESM-6 a été démonté en 1992.
|
1965 : Ted Nelson publie un premier papier sur le concept de nombreux types de documents informatiques reliés entre eux. Il utilise les mots hypertexte et hypermedia pour décrire ce concept, par la suite plus connu sous le nom de Xanadu.
1965 : Lawrence G. Roberts va, avec Thomas Merill, connecter l'ordinateur TX-2 au Massachussets avec l'ordinateur Q-32 en Californie par une liaison téléphonique. Cette expérience va prouver la faisabilité et l'utilité d'un réseau d'ordinateurs. Elle va aussi achever de convaincre Roberts de la supériorité de la commutation de paquet par rapport à l'utilisation de circuits dédiés comme ce fût le cas dans cette expérience.
|

1965 : Premier super ordinateur à architecture vectorielle : l'ILLIAC IV de Burrough. Il combinait une architecture parallèle et pipe-line composée de 64 processeurs (256 processeurs avaient été prévus). Performance : 200 MIPS !
Cette machine fut un échec du fait d'énormes problèmes de mise au point. Le projet commença en 1964. Le premier Illiac IV fut installé à la Nasa en 1972 et il ne fonctionnera vraiment qu'a partir de 1975.
|
|

1965 : Digital présente le PDP 8, le premier mini ordinateur qui marque une étape importante dans la miniaturisation et la diminution du prix des ordinateurs. Une publicité montrait qu'on pouvait le transporter sur la banquette arrière d'un cabriolet Coccinelle. Son prix était 5 fois plus petit que celui du moins cher des IBM 360. Un microprocesseur CMOS-8 contenant le jeu complet d'instructions du PDP 8 sera même crée en 1976. Des machines basées sur ce jeu d'instructions seront vendues jusqu'en 1984 (DECmate III).
| Caractéristiques techniques du mini ordinateur PDP 8 |
Processeur 12 bits, cycle de 1.5 microsecondes
Mémoire 4Kmots de 12 bits (tores de ferrite)
Terminal Teletype ASR33 + cartes perforées
Consommation : 780 Watts - Prix : 18000 $ |
|
1965 : Gordon Moore écrit que la complexité des circuits intégrés doublera tous les ans. Cette affirmation qui s'est par la suite révélée exacte est maintenant connue sous le nom "Loi de Moore".
Mai 1966 : Steven Gray fonde le club Amateur Computer Society. On peut considérer qu'il s'agit de la naissance de l'informatique personnelle.
1966 : Le langage de programmation LOGO est crée par une équipe chez BBN (Bolt Beranek & Newman) dirigée par Wally Fuerzeig dont faisait partie Seymour Papert. Ce langage très graphique est basé sur le principe d'une tortue que l'on pilote à l'écran en lui donnant des ordres (tourner, avancer, etc...).
|

1966 : Création de la première console de jeu vidéo pour la maison par Ralph Baer : la Magnavox Odyssey I. Il s'agissait d'une console se branchant sur le téléviseur et disposant de 13 jeux sur 6 cartouche enfichables. Une option était disponible avec un pistolet à pointer sur la télé et 4 jeux additionnels l'utilisant.
Comme Pong ressemblait beaucoup à l'un des jeux de cette console, Magnavox intenta un procès contre Atari pour violation de Copyright.
|
|
 
1967 : Le département informatique de l'université de l'Utah, dirigé par les professeurs David C. Evans et Ivan Sutherland s'est spécialisé dans l'imagerie informatique en 3 dimensions.
On peut voir ci-contre leurs étudiants en train de numériser la Coccinelle d'Ivan Sutherland et le résultat à l'écran.
Ils fonderont la société Evans & Sutherland en 1968.
|
1967 : Lawrence G. Roberts, récemment arrivé à la tête du projet de réseau informatique à l'ARPA, publie ses "Plans pour le réseau ARPANET" au cours d'une conférence. Lors de cette conférence sera aussi publié un papier sur un concept de réseau à commutation de paquets par Donald Davies et Robert Scantlebury du NPL et également un papier de Paul Baran de la RAND au sujet de l'utilisation d'un réseau à commutation de paquet pour transmission sécurisée de la voix, même en cas de destruction partielle du réseau en cas de guerre nucléaire.
Il est amusant de noter que ces groupes ont travaillé en parallèle sur des concepts similaires et sans avoir connaissance des travaux des autres pour aboutir en même temps à la même conclusion !
C'est aussi à cause de la similitude entre le projet de la RAND et le projet de l'ARPA qu'est née la fausse rumeur selon laquelle le réseau ARPANET avait été lancé à cause du besoin de relier les ordinateurs entre eux par un réseau insensible aux destructions d'une guerre nucléaire.
1967 : IBM construit le premier lecteur de disquettes.
|
1967 : Voici un tableau récapitulatif du nombre d'ordinateurs produits lors de l'année 1967 :
|
| Rang |
Compagnies |
Production |
Part de marché |
| 1 |
IBM |
19773 |
50.0 % |
| 2 |
Rand |
4778 |
12.1 % |
| 3 |
NCR |
4265 |
10.8 % |
| 4 |
CDC |
1868 |
4.7 % |
| 5 |
Honeywell |
1800 |
4.6 % |
| 6 |
Burrough |
1675 |
4.2 % |
| 7 |
RCA |
977 |
2.5 % |
| 8 |
General Electric |
960 |
2.4 % |
| Autres |
3420 |
8.7 % |
| Total |
39516 |
100 % |
|
Aout 1968 : Lawrence G. Roberts et la communauté de chercheurs "sponsorisée" par l'ARPA ont défini la structure et les spécifications du futur réseau ARPANET. Ils lancent un appel d'offre pour la réalisation d'un composant clé du réseau : le commutateur de paquet appelé aussi IMP (Interface Message Processor). La société BBN (Bolt Beranek and Newman) remportera l'appel d'offre en Décembre 1968.
|

1968 : Douglas C. Engelbart de la Stanford Research Institute fait une démonstration d'un environnement graphique avec des fenêtres à manipuler avec une souris. Il démontre dans cet environnement l'utilisation d'un traitement de texte, d'un système hypertexte et d'un logiciel de travail collaboratif en groupe.
|
1968 : Burrough sort les premiers ordinateurs basés sur des circuits intégrés, les B2500 et B3500 qui marquent le début de la troisième génération d'ordinateurs.
|

1968 : Hewlet Packard présente sa première calculatrice de bureau programmable fonctionnant en notation Polonaise inversée (RPN), la HP 9100. Elle n'était pas constituée de circuits intégrés mais de transistors et d'une mémoire à tores de ferrite, ce qui explique sa taille et son poids de 20 Kg !
Caractéristiques :
- 196 pas de programmes ou 16 mémoires (se recouvrant, ce qui permet d'écrire du code automodifiable)
- lecteur enregistreur de cartes magnétiques (capacité : 196 pas de programme par carte)
- Affichage par écran cathodique.
- Prix : 5000 $
- Boite d'extension mémoire de 3472 pas de programme pour 3690 $
|
1968 : Création du langage PASCAL par Niklaus Wirth.
été 1969 Le Bell Lab d'AT&T se retire du projet MULTICS, considérant que celui-ci prendrait trop de temps pour arriver à un résultat concret.
Un groupe d'informaticiens mené par Ken Thompson et Dennis Ritchie avait commencé à réfléchir à la création d'un nouveau système d'exploitation temps partagé mais leur hiérarchie refusait d'en entendre parler.
Ils trouvèrent un Dec PDP 7 (ordinateur apparu en 1964, évolution du PDP-1) inutilisé (récupéré initialement par Thompson pour y faire tourner un jeu écrit par lui : Space Travel !) pour mettre leurs idées en pratique.
Certaines idées furent héritées du projet MULTICS : notion de process, système de fichiers arborescent, interpréteur ligne de commande tournant comme un simple programme utilisateur, représentation simple des fichiers texte et accès généralisé aux périphériques. D'autres nouvelles idées servirent de principe pour le développement : concevoir les outils comme un ensemble de petits programmes simples, faire en sorte que le résultat d'un programme puisse devenir l'entrée du programme suivant, etc...
Un noyau Unix primitif, un shell, quelques programmes utilitaires, un éditeur et un assembleur furent rapidement mis au point sur le PDP 7.
Ce n'est que par la suite qu'un nom fût trouvé par Brian Kernighan pour ce nouveau système d'exploitation : UNIX (par opposition au projet MULTICS).
Cette version est connue sous le nom "Unix Time-Sharing System V1".

Septembre 1969 : BBN installe le premier équipement réseau IMP (basé sur un mini-ordinateur Honeywell 516 avec 12 Ko de Ram, voir photo ci-contre) à l'UCLA et le premier ordinateur (XDS SIGMA 7) y est connecté. Un ordinateur (XDS 940) de l'équipe de Douglas C. Engelbart de la Stanford Research Institute est alors relié via une liaison à 50 kbits/s. Les premières données sont échangées entre ces machines. Peu après, un ordinateur (IBM 360/75) situé l'université de Santa Barbara et un autre (Dec PDP-10) situé à l'université de l'Utah à Salt Lake City sont raccordés. Le réseau ARPANET initial constitué de 4 ordinateurs est alors en fonctionnement fin 1969.
Voici un schéma de l'époque représentant ce réseau.
Lors d'une interview, le professeur Kleinrock de l'UCLA raconta la première expérience réalisée avec ce réseau : se connecter à l'ordinateur de la SRI depuis celui de l'UCLA en tapant LOGIN :
Nous avons appelé les gens de SRI par téléphone.
Nous avons alors tapé L puis demandé au téléphone "Vous voyez le L ?"
La réponse vint alors : "Oui, nous voyons le L"
Nous avons alors tapé O puis redemandé au téléphone "Vous voyez le O ?"
"Oui, nous voyons le O"
Nous avons alors tapé G et tout le système a crashé !!! |
|

1969 : Lancement du super ordinateur CDC 7600 développé par Seymour Cray. Evolution du CDC 6600, il est basé sur une architecture "pipeline".
|
1969 : Création de la norme de connexion série RS232.
|

Avril 1970 : Lancement de la ligne de mini-ordinateurs PDP-11 par Digital Equipment Corporation. Il s'agit d'une ligne de machines toutes compatibles entre elles basées sur un processeur 16 bits et qui rencontrera un grand succès.
|
Décembre 1970 : Le Network Working Group sous la direction de S. Crocker termine le protocole de communication entre ordinateurs pour le réseau ARPANET appelé Network Control Protocol ouNCP. De nouveaux ordinateurs furent rapidement branchés sur ARPANET et l'implémentation de NCP sur la période 1971-1972 permit aux utilisateurs de ce réseau de développer les premières applications.
1970 : Ken Thompson, pensant qu'UNIX ne serait pas complet sans un langage de programmation de haut niveau commence à porter le Fortran sur le PDP 7 mais change rapidement d'avis et crée en fait un nouveau langage, le B (en référence au BCPL dont il s'inspire).
1970 : Première puce mémoire crée par Intel et contenant l'équivalent de 1024 tores de ferrite très encombrants sur un carré de 0.5 mm de côté (capacité : 1kBit soit 128 octets)
1970 : Création par Xerox du centre de recherches PARC (Palo Alto Research Center) à Stanford. Le chercheurs du PARC travaillent dans la plus grande liberté, Xerox ne leur ayant pas assigné d'objectifs commerciaux. De nombreuses innovations sortiront du PARC mais Xerox ne saura jamais les exploiter correctement.
Il faut noter que plusieurs personnes du Xerox Parc ont avant travaillé avec Douglas Engelbart. L'équipe de recherche était dirigée par Bob Taylor qui avant avait dirigé l'équipe à l'origine du réseauARPANET.


/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F24%2F64%2F151797%2F25420517_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F74%2F70%2F151797%2F22402414_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F46%2F25%2F151797%2F17480489_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F42%2F151797%2F16987415_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F18%2F151797%2F16832953_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F2%2F128313.jpg)

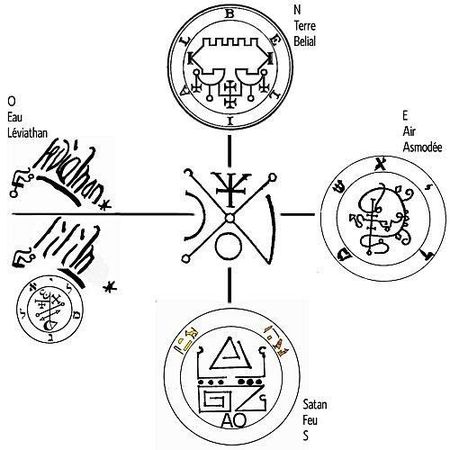



























 1958 : Démonstration du premier circuit intégré crée par Texas Instruments.
1958 : Démonstration du premier circuit intégré crée par Texas Instruments.